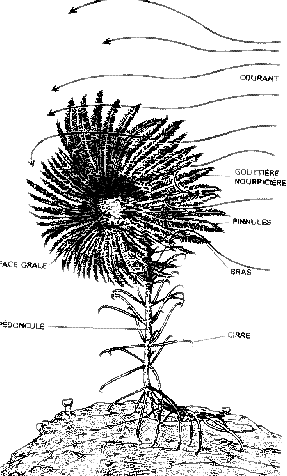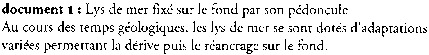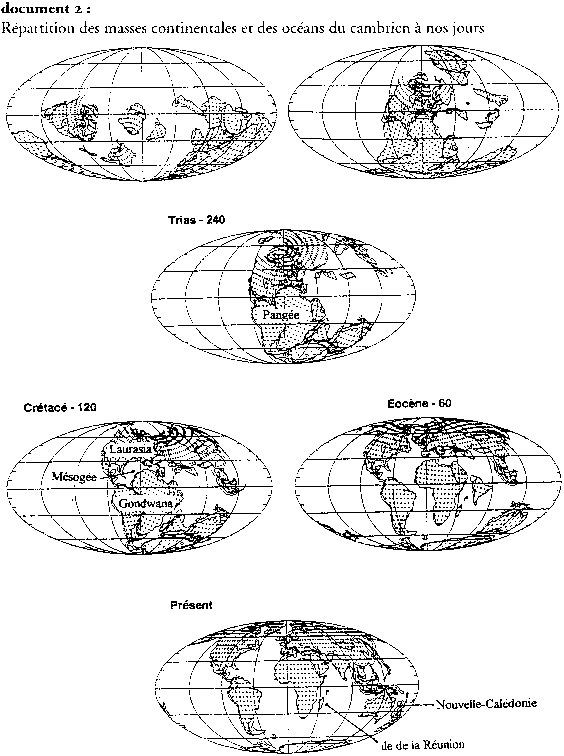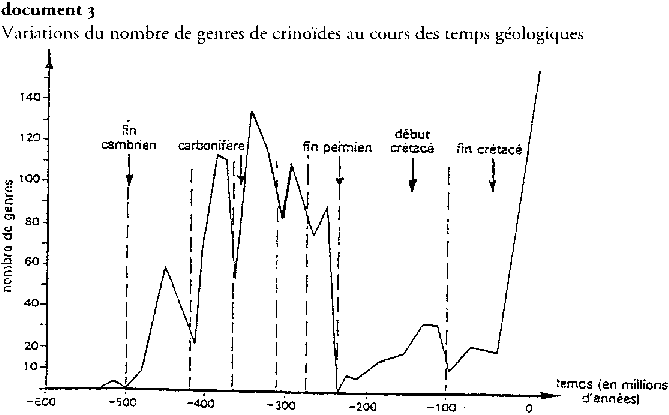|
Les
groupes d’êtres vivants évoluent dans le cadre de l’histoire de
la Terre. Certains de ces groupes ont pu la traverser sans disparaître
depuis l’ère primaire jusqu’à nos jours. L’évolution porte la
marque des grands changements lithosphériques.
L’exemple étudié, le lys de mer (document 1) est un représentant
actuel du groupe des crinoïdes, échinodermes proches des étoiles
de mer, qui vivent dans les océans jusqu’à 3000 mètres de profondeur.
Leur squelette calcaire permet d’identifier un nombre important
de formes fossiles et actuelles et de suivre leur évolution dans
l’espace et dans le temps.
A la fin du
jurassique, il y a 140 millions d’années, existait une faune
de crinoïdes dans la Mésogée, mer chaude et intertropicale qui,
à l’ère secondaire, s’est individualisée à partir de la Thétis
et qui a été tronçonnée au Miocène en plusieurs bassins dont la
Méditerranée.
À partir
de -100 millions d’années, on connaît beaucoup de crinoïdes
fossiles qui, sur des critères morphologiques spécifiques, peuvent
être répartis en ensembles différents occupant un des trois secteurs
océaniques : atlantique, indonésien, pacifique.
Très récemment
(depuis 1983), on a découvert sur les pentes sous-marines
de l’île de la réunion (océan indien), des spécimens vivants d’une
espèce déjà présente au Carbonifère (-300 millions d’années) et
on a pêché en Nouvelle Calédonie (Pacifique occidental) des spécimens
vivants du genre Gymnocrinus apparu
au Jurassique (-150 millions d’années).
On découvre
plus souvent des espèces appartenant à des genres fossiles datant
de moins de 100 millions d’années et proches des formes actuelles.
1) À
l’aide de ces données, de l’exploitation des documents 1
et 2 et des connaissances acquises sur l’évolution des espèces,
proposer des explications à la diversification et à la répartition
géographique actuelles des crinoïdes à partir de la faune jurassique.
2) Quelle
correspondance peut-on établir entre la répartition des océans
(document 2) et le nombre de genres de crinoïdes (document 3)
au cours du temps ?
3) En
conclusion à cette étude, montrer comment cet exemple permet d’illustrer
un aspect des relations qui existent entre l’évolution de la lithosphère
et celle de la biosphère.
|