Changements géologiques et modification de la biosphère
A) Évolution de la vie et coupures géologiques.
1) Évolution de la vie et la géologie des roches sédimentaires.
Au cours du temps il y a eu formation de dépôts
de roches sédimentaires au fond de la mer par couches superposées,
les plus anciennes étant au-dessous des plus récentes.
Chaque strate représente un intervalle de temps, le temps
fallu pour qu'elle se dépose. On peut essayer d'estimer la vitesse
de sédimentation et ainsi mesurer le temps correspondant au dépôt.
Ces strates diffèrent au niveau lithologique : il y
a des argiles, des calcaires … . Elles diffèrent aussi
selon leur contenu paléontologique, c'est à dire leur contenu
en fossiles. Certains fossiles existent dans plusieurs couches et d'autres
ne se retrouvent que dans une seule strate (ils ont donc disparu relativement
vite). On peut donc identifier des roches et leur âge selon les
fossiles qu'elle contient. Les fossiles permettant un tel repérage
sont dits fossiles stratigraphiques car l'espèce
fossilisée a eu une durée de vie suffisamment brève
pour qu'elle corresponde à une période donnée. Une
fossile stratigraphique doit aussi avoir pour qualités un nombre
élevé de représentants et une vaste aire de répartition.
Des associations de fossiles permettent aussi de dater les roches.
Lorsqu'il y a apparition d'espèces on dit qu'il y a
radiation tandis qu'une extinction
correspond à une disparition. Ces phénomènes constituent
des repères chronologiques. Les espèces disparaissent régulièrement
mais il y a des périodes d'extinction massives.
2) Des périodes d'extinction massives.
Crises biologiques.
Il n'y a pas de disparitions
brutales mais des régressions progressives d'espèces.
Dans l'exemple de l'extinction du genre Gephyrocapsa,
il y a évolution biologique par un remplacement progressif du genre
par un autre, Emiliana. Si on analyse les
différentes espèces du genre Gephyrocapsa
on voit que la régression du genre s'explique par celle de l'espèce
Gephyrocapsa ericsonii-protohuxleyi.
En fait seule l'espèce Gephyrocapsa oceanica
se maintient.
Les crises marquent toujours la transition entre deux périodes
ou deux ères. C'est le cas par exemple de la crise la plus importante
vécue par la biosphère, à la fin du Permien et qui
a servi à marquer le passage de l'Ère primaire à
l'Ère secondaire.
Une telle crise est marquée
par un taux d'extinction très élevé, une courte durée
à l'échelle des temps géologiques (environ 10 Ma)
et une extension mondiale. Elles sont généralement
dues à des modification environnementales (climat …) ou
à des événements catastrophiques de nature extraterrestre
(météorites) et terrestres (volcanisme).
Crises et temps géologiques.
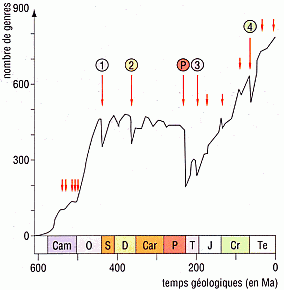 On
utilise ces crises pour marquer des époques
géologiques et construire l'échelle stratigraphique.
Les ères correspondent à l'apparition
ou à la disparition de groupes entiers d'organismes :
On
utilise ces crises pour marquer des époques
géologiques et construire l'échelle stratigraphique.
Les ères correspondent à l'apparition
ou à la disparition de groupes entiers d'organismes :
- Précambrien - Ère primaire :
apparition de fossiles d'organismes à tests minéralisés.
- Ère primaire - Ère secondaire :
disparition d'animaux marins.
- Ère secondaire - Ère tertiaire :
développement des mammifères, oiseaux et plantes à
fleur.
- Ère tertiaire - Ère quaternaire :
marque l'apparition de l'homme, elle est pour l'instant totalement artificielle
car cela c'est fait sans grande crise mais le libre cours laissé
à la folie destructrice des hommes pourrait justifier l'usage de
ce terme dans un proche avenir.
Les crises de moindre importance sont utilisées pour
découper les ères en étages.
Ces étages sont caractérisés par une lithologie propre
et une association particulière de fossiles stratigraphiques. Leur
nom se termine en "-ien".
Ces étages sont ensuite divisés en sous-étages
et regroupés en systèmes ou
périodes : Crétacé,
Jurassique … . Une période correspond à un grand
cycle sédimentaire.
B) Crise Crétacé - Tertiaire ou Crétacé - Paléocène.
1) La biosphère au Secondaire (dont Crétacé).
Il y avait alors peu de terres émergées. Il
dominait donc un climat océanique chaud avec de fortes précipitations.
Le climat tendait vers le tropical sur la majeure partie du monde, y compris
les pôles.
Chez les plantes, il y avait :
- beaucoup de fougères ;
- des gymnospermes (conifères) ;
- apparition d'angiospermes (magnolia,
palmiers …) vers la fin du Crétacé ;
- des planctons végétaux (phytoplancton) comme
les coccolithophoridés dont l'accumulation
de test est à l'origine du calcaire.
Au niveau animal, il y avait une multitude d'invertébrés
aquatiques et terrestres :
- crustacés ;
- oursins ;
- des planctons animaux (zooplancton) : foraminifères ;
- des mollusques dont les rudistes
(mollusques bivalves, fixés et récifaux, à coquille
épaisse, qui vivaient dans les mers chaudes), ammonites
(mollusques céphalopodes à coquille externe) et bélemnites
(mollusques céphalopodes proches de la seiche) ;
- des reptiles : vertébrés dominants d'une
très grande diversité, vivant dans tous les milieux et occupant
toutes les niches écologiques : lézards, sauriens,
tortues, dinosaures, lézards volants (ptérosaures),
ichtyosaures, plésiosaures … ;
- de rares mammifères insectivores ou phytophages proches
des rats.
2) Une crise biologique mondiale.
Il y a eu une forte diminution du nombre de genres entre
le Crétacé et le Paléocène vers il y a 65 Ma,
avec une disparition d'une centaine de genres.
Chez les végétaux les changements sont faibles :
- disparition totale des bennettitales ;
- prolifération des plantes à fleurs (dicotylédones
et monocotylédones).
À la limite Crétacé - Tertiaire,
il y a prééminence des spores de fougères, alors
que de part et d'autre de la limite, les pollens abondent. On en déduit
qu'avant il y avait beaucoup de gymnospermes et d'angiospermes mais qu'il
y a pratiquement eu extinction de ces espèces au profit des fougères,
végétaux opportunistes. On peut donc se demander s'il s'est
produit quelque chose de néfaste.
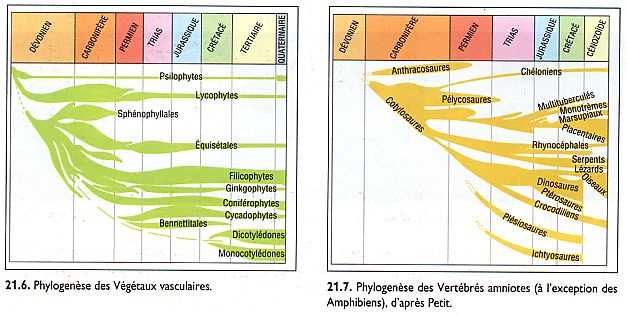
Par contre chez les animaux, on constate un phénomène
plus brutal :
- disparition des dinosaures et ptérosaures chez les
vertébrés continentaux (dans l'ensemble les crocodiliens
et les tortues ont survécu) ;
- en milieu marin, extinction des plésiosaures et ichtyosaures,
des ammonites, bélemnites et rudistes. Les mollusques et les oursins
sont très touchés, et 50% des espèces de planctons
(y compris végétaux) disparaissent : les foraminidés
sont décimés et 90% des coccolithophoridés disparaissent.
Il y a donc bien eu une crise biologique qui a affecté
tous les milieux (continental et aquatique) dans le monde entier.
3) Identification de la limite Crétacé - Tertiaire.
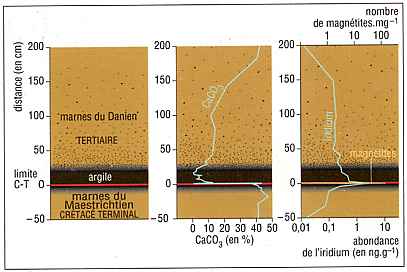 On
peut identifier cette limite Crétacé - Tertiaire
à l'échelle du globe. La couche représentant cette
époque est en effet caractérisée par une couche d'argile
noirâtre, que l'on retrouve un peu partout dans le monde. Celle-ci
s'oppose à des couches calcaires blanches du Crétacé
et beiges du Tertiaire. La couche fait quelques centimètres d'épaisseur
et ne contient aucune trace de fossiles.
On
peut identifier cette limite Crétacé - Tertiaire
à l'échelle du globe. La couche représentant cette
époque est en effet caractérisée par une couche d'argile
noirâtre, que l'on retrouve un peu partout dans le monde. Celle-ci
s'oppose à des couches calcaires blanches du Crétacé
et beiges du Tertiaire. La couche fait quelques centimètres d'épaisseur
et ne contient aucune trace de fossiles.
Le calcaire blanc situé au-dessous renferme des microfossiles
marins typiques de la fin du Crétacé, et le calcaire beige,
situé au-dessus montre que les microfossiles du Crétacé
ont été remplacés par d'autres, typiques de la base
du Tertiaire (Paléocène). Il y a donc eu un renouvellement
de microfossiles après la crise. Mais si le couche argileuse est
dépourvue de fossiles c'est sans doute qu'il n'y avait guère
d'êtres vivants à l'époque de la crise.
La teneur en CaCO3 chute brusquement dans
la couche de la limite : à la fin du Tertiaire elle est de
40% contre 5% au moment du dépôt. Or le calcaire a une origine
biologique ce qui laisse penser qu'il y a eu quasi-disparition des espèces
à test calcaire (plancton principalement).
D'autre part cette couche a un taux d'iridium très élevé
à un moment donné (c'est le pic d'iridium)
et de magnétites (pic de magnétites)
qui permettent de la repérer.
Ce sont ces données lithologiques (argile au lieu de calcaire),
paléontologiques (pas de fossiles) et géochimiques (pics
d'iridium et de magnétites) qui caractérisent à l'échelle
mondiale la limite Crétacé - Tertiaire.
4) Après la crise, le Tertiaire.
Les grands groupes qui n'ont pas disparu se développent
et se diversifient :
- il y a apparition de graminées,
qui vont causer l'expansion de prairies qui pourront être colonisées
par des herbivores ;
- les mammifères en profitent pour proliférer
et vont occuper toutes les niches écologiques libérées
par la régression des reptiles ;
- prolifération des oiseaux ;
- la vie reprend dans les milieux marins : les coraux
remplacent les rudistes dans la construction de récifs, chez les
foraminifères les globigénines,
seuls survivants du genre, vont reprendre le contrôle des eaux.
Il s'agit donc de l'ère de la domination des insectes, oiseaux
et mammifères.
Toutes les espèces qui apparaissent après une
crise ont pour origine des espèces qui existaient déjà
et qui ont survécu à la crise. Les crises
biologiques permettent donc un renouvellement des flores et des
faunes. Le repeuplement s'effectue par l'intermédiaire d'espèces
qui ont connu une complexification et une diversification par rapport
à celles qui les précédaient.